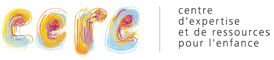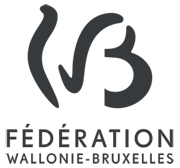Saviez-vous que… la caméra frontale a fait du selfie un geste quotidien avec l’arrivée de l’iPhone 4 en 2010 ? Au départ spontané, il devient rapidement un outil de mise en scène de soi : filtres rigolos sur Snapchat, puis filtres “parfaits” sur Instagram. Pommettes rehaussées, lèvres repulpées, peau lissée : l’image retouchée s’impose comme nouveau standard et certain·es vont jusqu’à modifier leur visage pour ressembler à leur version filtrée. Le selfie est entré dans notre quotidien, il est encadré par des codes esthétiques… parfois pensé pour capter l’attention, susciter des likes, ou entretenir une image publique1Pour aller plus loin dans le détail : « Le selfie a vingt ans : vive le selfie » par Laïma A. Gerald, Urbania, 7 juin 2022 [Consulté le 25 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://urbania.ca/article/le-selfie-a-vingt-ans-vive-le-selfie.
- Quelle image de soi renvoie-t-on dans un monde où se montrer est devenu… une performance ? À quel âge commence-t-on à se scruter, à se comparer, à se mettre en scène ? Les ados peuvent-ils encore se construire sans miroir numérique ? Quelle place pour l’estime de soi dans une culture du like et du filtre
Saviez-vous que… le geste de “swiper” (faire glisser) est devenu l’un des réflexes les plus répandus du monde numérique ? Né avec l’iPhone en 2007 et popularisé par l’application de rencontre Tinder quelques années plus tard, il suffit de balayer l’écran pour aimer ou rejeter, passer ou choisir : à droite, j’aime, à gauche, je zappe. Ce geste simple, rapide, intuitif… et souvent impulsif, a changé notre façon de décider. Rencontres, vidéos, photos, produits : tout peut désormais se trier d’un seul doigt. Aujourd’hui, des enfants en bas âge savent swiper avant même de savoir parler. Parfois, ce geste répété complique la préhension au point qu’ils ont du mal à saisir les objets : on parle alors du “syndrome des mains papillons2Le « syndrome des mains papillons » décrit des enfants dont la motricité fine est insuffisante pour saisir correctement des objets. Le développement normal de la préhension commence vers 4 mois, se perfectionne entre 9 et 12 mois, mais l’usage répété des écrans tactiles favorise des gestes de frôlement qui empêchent les doigts de se refermer correctement sur les objets. Information issue de « Les mains papillon » par L’Office Communautaire d’Animations et de Loisirs, 27 novembre 2023 [Consulté le 27 août 2025]. https://assolocal.fr/ressource-parent/les-mains-papillons/”.
- Comment ce geste, devenu naturel, influence-t-il notre patience, notre attention… notre rapport à l’autre ?
Saviez-vous que… notre manière de passer d’un contenu à l’autre est devenue un réflexe culturel ?
Le zapping est né avec la télécommande, dans les années 80. D’abord réservé à la télé — changer de chaîne pour éviter la pub — il est devenu un mode de vie numérique : on scrolle, on swipe, on ouvre trois onglets, on lance une série en répondant à un message. On ne change plus seulement de chaîne : on change de fenêtre, de plateforme, d’univers — en quelques secondes. Le zapping n’est plus un simple geste, c’est une culture : celle de la distraction permanente et du multitâche. Mais sa contrepartie est lourde : 41 % des tâches interrompues ne sont jamais reprises3Information issue de : « Culture zapping : Jusqu’où nous mènera le règne de l’instantanéité », par Meele, Mon enfant et les écrans [en ligne], publié le 2 avril 2024 et mis à jour le 9 juin 2025 [Consulté le 25 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/culture-zapping-jusquou-nous-menera-le-regne-de-linstantaneite/.
- Productivité ou illusion d’efficacité ? Et si ce papillonnage constant nuisait à notre attention et à notre bien-être ? Un enfant peut-il encore suivre une histoire complète… quand il apprend très tôt à passer à autre chose dès que l’ennui arrive ?
Saviez-vous que… quelques signes ont suffi à bouleverser notre manière de communiquer ? Avec l’arrivée des SMS (il y a plus de 25 ans), un nouveau langage s’est imposé : sans accents, truffé d’abréviations (“bjr”, “jtm”, “dsl”), écrit comme on parle (“koi”, “kel”), souvent orné d’émojis pour exprimer l’émotion. Un code rapide, direct, inventif, né de contraintes techniques… mais devenu un espace d’expression propre, en particulier pour les ados : plus libre, plus intime. Même si les messageries instantanées ont pris le relais, cet héritage reste bien présent dans notre manière d’écrire… et de nous parler.
- Qu’exprime-t-on vraiment en quelques mots, quelques symboles ? Le ton d’un message écrit peut-il vraiment tout dire ? Que devient le non-verbal quand on ne communique plus que par écrans ? Que reste-t-il de l’attention à l’autre ?
Saviez-vous que… avec les premiers téléphones équipés d’un appareil photo (dès 2002), notre rapport à l’image a basculé ? Avant, pour prendre une photo, il fallait d’abord avoir un appareil sous la main. Immortaliser un moment, c’était réfléchi, volontaire, parfois exceptionnel. Aujourd’hui, il suffit… de sortir son téléphone. Avec les téléphones équipés d’un appareil photo, la frontière entre vivre et documenter s’est estompée. Place à l’instantané, au partage immédiat (sur les réseaux), à l’image continue que l’IA retouche avant même qu’on ait cligné des yeux. Aujourd’hui, chaque repas, chaque sortie, chaque sourire peut devenir une photo. Et parfois, il le devient avant même qu’on ait vécu l’instant. Les souvenirs sont moins racontés… que sauvés, archivés, stockés. Pour les enfants, cela change tout : grandir, c’est être photographié — parfois tous les jours, souvent sans le demander. Ils se découvrent à travers le regard d’un adulte derrière son smartphone.
- Mais si tout est capturé, que devient l’intimité ? Et que fait-on des souvenirs qui n’ont jamais eu le temps d’exister hors image ?
Saviez-vous que… certaines peluches sont dotées d’intelligence artificielle4Nous nous référons à la peluche ARY développée par The Data Driven Company Lookiz, en pré-commande, distribution prévue en septembre 2025 [site consulté le 25 août 2025] https://lookiz.io/ ? Elles interagissent avec l’enfant (sans connexion Internet). Elles proposent des interactions vocales, des dialogues, et des récits adaptés à l’âge de l’enfant. … mais toujours dans les limites d’un programme prédéfini.
- Quand la peluche guide la discussion, que reste-t-il de la créativité spontanée et de l’imaginaire ? Et quand un jouet parle, rassure et comprend, comment se redéfinit le rôle de l’adulte dans le lien affectif et l’acquisition du langage ?
Saviez-vous que… d’autres peluches sont connectées à distance5Nous nous référons ici à la peluche HEEHEE développée par Alecto [site consulté le 25 août 2025] https://www.alectobaby.nl/fr/products/alecto-baby-heehee-knuffelbeer-babbel-button-maak-van-je-knuffel-een-interactief-vriendje ? Les parents peuvent y enregistrer des messages ou faire parler la peluche en direct avec une autre voix : l’enfant croit parler à sa peluche, mais c’est l’adulte qui l’écoute, à travers l’objet.
- Est-il souhaitable que les parents communiquent par ce biais à leur enfant ? Peut-on récolter les secrets d’un enfant par l’intermédiaire d’un jouet ? Et où vont les données partagées dans ces confidences ?
Saviez-vous que… on ne regarde plus les séries comme avant ? Autrefois, une série, c’était un rendez-vous hebdomadaire, un épisode à une heure précise. Enfant, on en parlait le lendemain à l’école, parfois on rejouait même les scènes à la récré. Aujourd’hui, on les enchaîne sans limite, parfois jusqu’au bout de la nuit. Le binge-watching (ou visionnage boulimique) s’est imposé depuis que Netflix a mis en ligne l’entièreté de la série « House of cards » en 2013. Tout s’enchaine même automatiquement, plus besoin d’attendre… mais à quel prix ? Le temps semble disparaître, avalé par le “juste un dernier épisode”. Le cerveau, sans pause, reste en tension permanente. La discussion autour d’une série devient plus rare : chacun·e regarde seul·e, à son rythme, en évitant les spoilers. Le plaisir s’accélère, se dilue… on consomme, parfois sans savourer. Regarder devient un automatisme : on “termine” une série comme on vide un paquet de chips.
- Est-ce encore du loisir… ou une injonction invisible à ne rien rater ? Sait-on encore s’arrêter ? Attendre ? Désirer ? Et les enfants aussi binge-watchent ?
Sur YouTube et YouTube Kids, les vidéos — dessins animés, challenges, déballages de jouets, histoires racontées ou compilations en boucle — s’enchaînent automatiquement, souvent sans fin, comme les épisodes d’une série sur Netflix. Même logique, même réflexe : “encore une”… puis une autre.
Saviez-vous que… les premières webcams ont été inventées pour surveiller… une cafetière ? 6En 1991, à l’université de Cambridge, des chercheurs ont installé une caméra pour vérifier à distance si la cafetière était encore pleine, fatigués des allers-retours vers une cafetière videInformation issue de l’article « La webcam a été inventée pour filmer une machine à café », publié le 03/11/2020 et mis à jour le 19/09/2023 sur le blog Code Garage [site consulté le 27 août 2025] https://code-garage.com/blog/la-webcam-a-ete-inventee-pour-filmer-une-machine-a-cafe. C’était pratique. Anodin. Depuis, les caméras se sont glissées partout : dans nos rues, nos maisons, nos écoles, nos voitures… et même dans les jouets. Elles veillent sur nos bébés, filment les entrées de nos immeubles, et parfois, enregistrent nos moindres gestes à notre insu. La frontière entre sécurité et surveillance devient floue.
- Une caméra pour se rassurer ? Pour contrôler ? Pour prévoir ? Pour observer qui… et pourquoi ? Peut-on apprendre la confiance dans un monde où tout est enregistré ? Et que devient l’intimité, si elle n’est jamais vraiment hors champ ?
Saviez-vous que… 80% des personnes consultent leur smartphone dans les 15 premières minutes après le réveil7Selon une étude menée en 2024 aux États-Unis, environ 80% des personnes consultent leur smartphone dans les 15 minutes après le réveil, dont 62% immédiatement, et 44% parce qu’il sert de réveil https://www.cbsnews.com/philadelphia/news/study-80-of-people-grab-smartphone-within-15-minutes-of-waking [site consulté le 27 août 2025]
Au Royaume-Uni et en Irlande, une étude de début 2025 indique que 94 % des personnes utilisent leur téléphone dans les 5 minutes suivant leur réveil https://madtechmag.com/2025/01/06/94-of-brits-irish-use-tech-within-5-minutes-after-waking-up-study-finds [site consulté le 27 août 2025].
En France, 87 % des Français utilisent leur smartphone dès le matin après le réveil d’après une enquête IFOP pour « Agir pour l’Environnement » en janvier 2024 https://ifopwebsiterecette.ifop.com/publication/les-francais-et-laddiction-au-numerique [site consulté le 27 août 2025? Cette habitude matinale est devenue banale : elle expose dès l’aube à un flot de notifications, souvent avant même le premier café. Ce premier geste du matin définit souvent le ton de la journée.
- Ce geste automatique est-il vraiment un besoin… ou juste un réflexe appuyé par des notifications ? Est-ce encore un acte conscient ou un début de journée commandé par une machine ? Comment reconnecter le matin à soi-même, au monde, ou à une activité sans écran ? Que transmet-on aux enfants quand le smartphone devient, pour les adultes, le premier geste du matin ?
Ces anecdotes montrent que nos gestes numériques ne sont jamais de simples automatismes : ils traduisent une culture en mouvement, qui influence nos relations, notre rapport au temps, à l’image, à la mémoire… et à nous-mêmes. Par l’usage répété, ils deviennent des pratiques enculturées : intégrées, intériorisées, au point de sembler naturelles.
Cette enculturation8Voir à ce sujet : LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. 17 juin 2025, p. 32-33. Extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/ influence aussi ce que nous transmettons aux enfants et adolescents qui grandissent dans ce bain numérique.
Interroger ces pratiques, c’est se donner l’occasion de prendre du recul : qu’est-ce qui relève du choix, qu’est-ce qui relève du réflexe ? Quelle place voulons-nous laisser à l’attention, à l’imaginaire, à la rencontre — dans un monde où l’écran accompagne chaque geste ?
Et surtout : que transmettons-nous aux enfants quand ces habitudes deviennent le cadre implicite de leur quotidien ? Car derrière chaque geste devenu banal se cache une question essentielle : quelle culture numérique voulons-nous construire ensemble ?
Notes de bas de page
- 1Pour aller plus loin dans le détail : « Le selfie a vingt ans : vive le selfie » par Laïma A. Gerald, Urbania, 7 juin 2022 [Consulté le 25 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://urbania.ca/article/le-selfie-a-vingt-ans-vive-le-selfie
- 2Le « syndrome des mains papillons » décrit des enfants dont la motricité fine est insuffisante pour saisir correctement des objets. Le développement normal de la préhension commence vers 4 mois, se perfectionne entre 9 et 12 mois, mais l’usage répété des écrans tactiles favorise des gestes de frôlement qui empêchent les doigts de se refermer correctement sur les objets. Information issue de « Les mains papillon » par L’Office Communautaire d’Animations et de Loisirs, 27 novembre 2023 [Consulté le 27 août 2025]. https://assolocal.fr/ressource-parent/les-mains-papillons/
- 3Information issue de : « Culture zapping : Jusqu’où nous mènera le règne de l’instantanéité », par Meele, Mon enfant et les écrans [en ligne], publié le 2 avril 2024 et mis à jour le 9 juin 2025 [Consulté le 25 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/culture-zapping-jusquou-nous-menera-le-regne-de-linstantaneite/
- 4Nous nous référons à la peluche ARY développée par The Data Driven Company Lookiz, en pré-commande, distribution prévue en septembre 2025 [site consulté le 25 août 2025] https://lookiz.io/
- 5Nous nous référons ici à la peluche HEEHEE développée par Alecto [site consulté le 25 août 2025] https://www.alectobaby.nl/fr/products/alecto-baby-heehee-knuffelbeer-babbel-button-maak-van-je-knuffel-een-interactief-vriendje
- 6En 1991, à l’université de Cambridge, des chercheurs ont installé une caméra pour vérifier à distance si la cafetière était encore pleine, fatigués des allers-retours vers une cafetière videInformation issue de l’article « La webcam a été inventée pour filmer une machine à café », publié le 03/11/2020 et mis à jour le 19/09/2023 sur le blog Code Garage [site consulté le 27 août 2025] https://code-garage.com/blog/la-webcam-a-ete-inventee-pour-filmer-une-machine-a-cafe.
- 7Selon une étude menée en 2024 aux États-Unis, environ 80% des personnes consultent leur smartphone dans les 15 minutes après le réveil, dont 62% immédiatement, et 44% parce qu’il sert de réveil https://www.cbsnews.com/philadelphia/news/study-80-of-people-grab-smartphone-within-15-minutes-of-waking [site consulté le 27 août 2025]
Au Royaume-Uni et en Irlande, une étude de début 2025 indique que 94 % des personnes utilisent leur téléphone dans les 5 minutes suivant leur réveil https://madtechmag.com/2025/01/06/94-of-brits-irish-use-tech-within-5-minutes-after-waking-up-study-finds [site consulté le 27 août 2025].
En France, 87 % des Français utilisent leur smartphone dès le matin après le réveil d’après une enquête IFOP pour « Agir pour l’Environnement » en janvier 2024 https://ifopwebsiterecette.ifop.com/publication/les-francais-et-laddiction-au-numerique [site consulté le 27 août 2025 - 8Voir à ce sujet : LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. 17 juin 2025, p. 32-33. Extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/