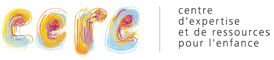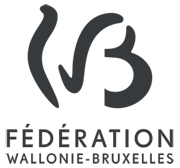L’interdiction est régulièrement au centre de débats publics concernant la régulation des écrans chez les enfants et ados.
Actuellement, deux mesures font particulièrement l’objet de discussions : l’interdiction pour les élèves d’utiliser leur smartphone dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dès l’année scolaire 2025-2026, d’une part, et la question d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, d’autre part.
À cela s’ajoute, en France, un récent arrêté interdisant l’exposition aux écrans des moins de trois ans dans les lieux d’accueil.
Notre analyse propose, à partir de ces trois exemples, d’aboutir à une réflexion sur l’interdiction comme mesure politique de régulation des écrans chez les enfants – qu’ils soient tout-petits ou ados.
Que faut-il en penser ? Pourquoi (ne pas) interdire ? Est-ce une mesure politique suffisante ? Judicieuse ? À quelles conditions ?
Chez les tout-petits : en France, l’interdiction dans les lieux d’accueil
En France, depuis ce 3 juillet 2025, la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant prévoit qu’« il est interdit d’exposer un enfant de moins de trois ans devant un écran (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) compte tenu des risques pour son développement. L’enfant a besoin d’interagir avec son environnement, d’utiliser ses cinq sens et d’être en mouvement1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant (mis à jour le 3 juillet 2025). [Consulté le 14 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044126586 ».
En prenant un arrêté qui modifie la phrase initiale « il n’est pas recommandé de laisser un enfant de moins de trois ans devant un écran […] » en « il est interdit d’exposer un enfant de moins de trois ans devant un écran […] », la ministre française du travail, de la santé, des solidarités et des familles signe ce qui semble être une première mondiale, car nous ne trouvons pas de texte légiférant de la sorte dans un autre pays. Il est par contre plus habituel de trouver des recommandations en ce sens2Par exemple chez nous en Belgique mais aussi en Allemagne, en Suède, au Québec… .
Cette interdiction nous paraît relever d’une nécessité avérée au vu des connaissances accumulées sur les impacts des écrans sur les tout-petitsV3oir à ce sujet notre étude : LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. Juin 2025. Sommaire et extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/ .
Ainsi, il nous semblerait assez logique que d’autres pays – y compris, chez nous, la Fédération Wallonie-Bruxelles – adoptent prochainement la même mesure ; tout comme il serait également judicieux de l’étendre aux moins de 6 ans.
D’un point de vue critique, relevons déjà un angle mort (fréquent voire constant) de ce texte, qui n’évoque pas l’utilisation des écrans par les adultes en présence des enfants – pourtant susceptible aussi d’impacter négativement le développement du tout-petit, en particulier au niveau de l’attachement et du sentiment de sécurité4Voir à ce sujet nos réflexions sur les smartphones des adultes au sein des organisations et des collectivités dans LETERME, 2025, p. 66-68. .
Enfin, notons qu’il s’agit d’une mesure politique peu coûteuse, car ne nécessitant aucun moyen financier ou autre, à l’instar de l’interdiction suivante que nous allons examiner : celle des smartphones dans les écoles.
Dans les écoles : l’interdiction d’utiliser son smartphone
Dès la rentrée d’août 2025, dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
[l]’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école […] et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école5PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, 2025. « Décret relatif à l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école ». 13 mars 2025. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/textes-normatifs/2025-04/53356_0002.pdf .
Cette mesure a fait l’objet de nombreux commentaires dès son annonce (sur lesquels nous ne reviendrons pas en détail).
Par rapport à l’objet de notre analyse, relevons quelques points qui posent question.
Tout d’abord, cette interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables dans les écoles ne touche que les élèves, et pas les membres de l’équipe éducative.
Cela nous semble problématique si ces dernier·es ne limitent pas, également, leurs usages numériques (via leur téléphone ou d’autres objets) aux strictes fins pédagogiques… Car les adolescent·es ne sont évidemment pas les seul·es à consulter des applications ou contenus numériques à des fins privées et/ou récréatives6Selon la récente Enquête nationale de Santé réalisée par Sciensano en collaboration avec Statbel, près de 7 Belges (de plus de 15 ans) sur 10 consacrent plus de 4 heures par jour à des activités sur écrans (vidéos, réseaux sociaux, diverses activités sur internet ou jeux vidéo) pendant leur temps libre. FALCINELLI, Sylvia, 2025. « Et chez vous, comment se porte votre temps d’écran ? Où en êtes-vous par rapport à la moyenne belge ? ». rtbf actus [en ligne]. 11 juillet 2025 [Consulté le 16 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/article/et-chez-vous-comment-se-porte-votre-temps-d-ecran-ou-en-etes-vous-par-rapport-a-la-moyenne-belge-11574362 .
Or la cohérence est importante dans la sphère éducative, notamment pour éviter d’exacerber le sentiment d’injustice des jeunes à l’égard des adultes.
Par ailleurs, si le décret du 13 mars 2025 donne quelques indications pour la mise en place de l’interdiction7Ces indications sont : référence à l’interdiction dans le règlement d’ordre intérieur de l’école, explication aux élèves lors de l’inscription et communication régulière auprès des parents et des membres du personnel. , on n’y retrouve aucune mesure concrète concernant une programmation systématique et régulière d’éducation aux médias dès le plus jeune âge, dispensée par des personnes compétentes.
« Malgré une reconnaissance officielle de l’importance des enjeux éducatifs et sociétaux portés par l’éducation aux médias, celle-ci reste toutefois peu intégrée dans les écoles et elle n’est formellement inscrite ni dans la scolarité ni dans la formation des enseignant·es8VALENTE SOARES, Marie, VREBOS, Pascal, SYLIN, Michel, 2024. « Éducation aux médias : Des dispositifs pédagogiques à penser ». La Ligue [en ligne]. 11 mars 2024. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://ligue-enseignement.be/education-enseignement/articles/dossier/education-aux-medias-des-dispositifs-pedagogiques-penser », doit-on déplorer à ce sujet.
Enfin il est questionnant, au niveau éducatif, d’imposer une mesure d’interdiction (potentiellement répressive) touchant à des comportements devenus presque existentiels pour nombre de jeunes sans concertation avec elles·eux.
Rappelons d’ailleurs que les enfants et adolescent·es ont, en vertu de l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, le droit d’être entendu·es sur toutes les questions les concernant.
La mise en application de l’interdiction des smartphones devrait donc s’accompagner d’une véritable concertation avec les élèves, pour qu’ils·elles puissent s’exprimer sur ce changement et les éventuels aménagements de la vie dans l’enceinte de l’école qui pourraient en découler : ce serait ainsi l’occasion de garantir leur participation dans l’amélioration du climat scolaire9À ce sujet, voir notre analyse : LETERME, Caroline, 2020. « L’école, lieu d’apprentissage de la démocratie ? ». CERE asbl [en ligne]. 3 mars 2020. Disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/ecole-lieu-dapprentissage-de-la-democratie/ .
Les réseaux sociaux : vers une interdiction aux moins de 15 ans ?
Autre débat en cours : l’éventuelle interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. L’Union Européenne avance à ce sujet, en ouvrant la voie à « une régulation renforcée des réseaux sociaux pour les mineurs ».
Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a précisé l’application du Digital Services Act (DSA), le règlement sur les services numériques, de la sorte : « chaque État membre pourra déterminer dans son droit national un âge minimal d’accès aux réseaux sociaux, et contraindre les plateformes à mettre en œuvre des mécanismes robustes pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs10Information et citation issues de : « Protection des mineurs : l’Union européenne précise les règles pour les plateformes ». Enfance & Jeunesse Infos [en ligne]. 15 juillet 2025. [Consulté le 17 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.enfancejeunesseinfos.fr/protection-des-mineurs-lunion-europeenne-precise-les-regles-pour-les-plateformes/ ».
La difficulté principale sera de faire porter la responsabilité de la mise en place des mesures de régulation – décidées par le pouvoir politique – de l’accès aux réseaux sociaux des plus jeunes par les plateformes.
Nel Broothaers, directrice générale de Child Focus, réclame à ce sujet une application stricte du Digital Services Act européen :
Une plateforme qui ne protège pas les enfants ne peut pas avoir accès à notre marché. L’Europe doit imposer ses règles : « Safety by design », dans l’intérêt des enfants. Ce qui revient à interdire les contenus nuisibles qui favorisent les comportements toxiques, empêcher que des inconnus puissent contacter librement les enfants en ligne, interdire les mécanismes addictifs (comme le scroll infini ou l’autoplay) pour les mineurs et veiller à ce que les algorithmes protègent et renforcent, au lieu de nuire11BROOTHAERTS, Nel (Child Focus), 2025. « Carte blanche : « Interdire les réseaux sociaux aux jeunes : brillante idée ou illusion de sécurité ? » ». rtbf actus [en ligne]. 26 juin 2025. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://www.rtbf.be/article/carte-blanche-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-jeunes-brillante-idee-ou-illusion-de-securite-11567327.
Interdire ne suffit pas…
En nous référant aux études et alertes des professionnel·les de la santé concernant les effets néfastes des numériques sur la santé et le développement, il est désormais suffisamment clair que des responsabilités, collectives et politiques, doivent être prises pour protéger les plus jeunes (des tout-petits aux ados).
Les adultes doivent garantir la protection des enfants, ce qui inclut un environnement – en l’occurrence numérique – sain et sécure dans lequel grandir (ici aussi, ce droit leur est garanti par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant). Comme l’écrit également Nel Broothaerts dans sa récente carte blanche :
[c]e qu’il nous faut, c’est une approche intelligente et courageuse, fondée sur une vérité simple : les enfants ont le droit à un monde numérique qui les protège et les renforce, un monde qui les inclut en toute sécurité, plutôt que de les exclure. Cela implique la mise en place d’un système progressif et sécurisé dans lequel ils apprennent pas à pas à naviguer en ligne, en fonction de leur âge. Oui, des limites d’âge peuvent faire partie du système, mais comme un rouage parmi d’autres […]12BROOTHAERTS, 2025..
Les deux premières interdictions décrites ci-dessus – celle d’exposer les enfants de moins de trois ans à un écran dans les lieux d’accueil et celle d’utiliser son téléphone portable à l’école pour les élèves – constituent des mesures relativement faciles à prendre pour les politiques.
Elles ne coûtent rien et ne nécessitent pas de dispositifs particuliers pour leur mise en place, qui repose sur le personnel des lieux d’accueil (pour les tout-petits en France) ou des écoles.
Aussi ces solutions risquent-elles de s’avérer inégalement suivies ; elles sont par ailleurs largement insuffisantes pour répondre de manière globale et adéquate aux défis complexes que posent les écrans aux différents âges de l’enfance et de l’adolescence.
Si une interdiction peut constituer un outil de régulation, encore faudrait-il qu’elle soit accompagnée d’autres mesures socio-éducatives plus ambitieuses dans le cadre d’un plan global de prévention.
Nous avons proposé quelques pistes en la matière pour la petite enfance dans notre récente étude Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises13LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. 17 juin 2025, p. 51-sv. Extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/ ?
Quant aux mesures concernant les adolescent·es, il est notamment primordial de
proposer à tou·te·s les jeunes, dans le cadre scolaire, une éducation aux médias basée sur l’échange entre jeunes et avec l’adulte, pour questionner les usages réels.
L’école remplit ainsi sa mission émancipatrice, en mettant en place un processus de réflexion commune qui passe par un dialogue et une sensibilisation à l’outil y compris aux difficultés et aux dérives qui y sont liées14CSEM, 2024. L’interdiction du smartphone à l’école. Collection « éclairages », n° 3. Septembre 2024, p. 7. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://www.csem.be/sites/default/files/2024-10/Eclairages%20smartphone%20(3).pdf .
… mais il n’est pas non plus interdit d’interdire
Pour autant, il n’est pas interdit d’interdire… Car cela reste un des moyens possibles pour garantir une certaine protection des plus jeunes – à accompagner d’un ensemble d’autres mesures de prévention, d’accompagnement et d’éducation, comme nous venons de l’expliciter.
Les produits numériques sont corrélés avec un grand nombre de problématiques de santé publique : divers retards et troubles du développement cognitif, psychomoteur et socio-relationnel chez les jeunes enfants ; problèmes de santé mentale, difficultés socio-relationnelles et troubles alimentaires dans des proportions inédites chez les adolescent·es.
Il est devenu évident que des mesures politiques plus fortes s’imposent, afin de mieux protéger et encadrer les enfants et adolescent·es.
Il ne s’agit certes pas d’être dans une logique répressive à leur égard, car comme le souligne Nel Broothaerts, « tant que nous resterons dans une logique d’interdiction et de contrôle de nos enfants, nous échouerons ».
Il nous semble qu’il ne devrait pas être tabou d’interdire aux jeunes l’accès à certains produits numériques associés à de telles problématiques de santé publique. Cela s’est fait par le passé avec d’autres produits nocifs comme l’alcool et le tabac, mais aussi les jeux de hasard.
Ne serait-il pas également bénéfique de gagner en clarté face à la nocivité de certains (més)usages des écrans par des mesures politiques concrètes de prévention et de protection ?
Certes, les smartphones et les réseaux sociaux ne sont ni entièrement, ni uniquement délétères pour la santé mentale des jeunes. Mais, comme le dit Laure Miller, rapporteuse de la commission d’enquête parlementaire française chargée d’enquêter sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineur·es :
malgré certaines nuances, il y a des effets psychologiques indéniables sur les plus jeunes, ce qui doit nous conduire à l’application d’une forme de principe de précaution. On ne peut pas, sous prétexte que certains jeunes peuvent avoir du recul sur cette application, sacrifier une partie de nos enfants qui, eux, peuvent subir un impact extrêmement néfaste de TikTok15TUAL, Morgan (propos recueillis par), 2025. « La commission d’enquête parlementaire sur TikTok fait son bilan : “Chaque mois qui passe sans régulation, des jeunes sont sacrifiés” ». Le Monde [en ligne]. 24 juin 2025. [Consulté le 17 juillet 2025]. Disponible à l’adresse :
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/06/24/la-commission-d-enquete-parlementaire-sur-tiktok-fait-son-bilan-chaque-mois-qui-passe-sans-regulation-des-jeunes-sont-sacrifies_6615666_4408996.html .
.
La complexité au cœur du débat
Les trois mesures d’interdiction décrites ci-dessus risquent bien de rester autant de mesures sparadraps face à un « désastre sanitaire » (pour reprendre les mots de Dr Mouton).
En effet, au-delà d’interdictions dans les lieux d’accueil de la petite enfance et les écoles, il demeure crucial de combler le vide juridique actuel dans la régulation des technologies numériques, notamment les plateformes de type GAFAM et autres réseaux sociaux, qui jouissent actuellement d’une impunité insoutenable au vu des dégâts causés sur la santé d’un nombre important jeunes16Dr Mouton rappelle que « nombre de publications soulignent ainsi le rôle néfaste des réseaux sociaux concernant les troubles de l’image corporelle et du comportement alimentaire, les actes d’automutilation (scarification), les tentatives de suicide et les suicides, sans oublier le cyberharcèlement qui, associé au harcèlement “classique”, a des répercussions plus sévères en raison de l’absence de refuge géographique ou temporel pour la victime et de la diffusion large et massive des images et messages harcelants ».Elle mentionne aussi les inquiétudes concernant l’usage exponentiel des chatbots d’intelligence artificielle : « effets sur [la] santé mentale [des jeunes usagers] des chatbots conversationnels investis comme “ami”, mais aussi amplification des pratiques pédocriminelles ». MOUTON, 2025, p. 19-20. .
Car les interdits doivent être posés à la source, à la mise en circulation des produits sur le marché – et non cibler uniquement les comportements des parents, enfants et/ou adolescent·es.
Dr Mouton plaide à ce titre pour une réglementation européenne qui s’inspirerait du processus d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament : « il s’agirait d’exiger des acteurs économiques qu’ils démontrent avant commercialisation l’absence d’effet nocif du produit et une balance bénéfice-risque favorable, puis que le produit soit régulièrement réévalué par des entités indépendantes […]17MOUTON, 2025, p. 34. ».
Il nous semble que la complexité du débat collectif et politique concernant ces mesures découle en grande partie de l’enculturation et l’aliénation numériques importantes – choisies, imposées et/ou subies – à l’œuvre dans notre société18Nous développons ces considérations sur l’enculturation et l’aliénation numériques dans notre étude susmentionnée : LETERME, 2025, p. 32-33 et 97-99. , couplées à la vitesse à laquelle évoluent les technologies numériques.
L’utilisation d’un smartphone, d’une connexion internet et, désormais, de l’IA fait partie des gestes quotidiens partagés par la quasi-totalité de la population, dès l’enfance.
Comment réguler les usages, équipements et accès numériques des enfants et des adolescent·es à un niveau collectif / politique, alors que toute la société qui les entoure regorge de numériques ?
Comment penser et proposer des dispositions suffisamment cohérentes et congruentes, comment justifier durablement des interdits à l’égard des plus jeunes alors que les adultes utilisent avidement écrans et pléthore d’applications, tant dans leur vie professionnelle que privée ?
On le voit : les interdits visant à préserver les enfants des effets néfastes des écrans sont à questionner et réfléchir plus largement, à l’aune de cette enculturation numérique.
Il s’agit en outre de repréciser, tenant compte de ce contexte, en quoi devraient consister une posture, un accompagnement et des pratiques éducatives de qualité dans le cadre de l’accueil et de la scolarité des tout-petits, des enfants et des adolescent·es.
Car, in fine, il s’agit aussi de privilégier des lois, des règles et des comportements qui, en intégrant certaines interdictions, favorisent l’adéquation avec la poursuite de valeurs, d’une éthique et d’un projet de société qui placent l’humain et le réel au centre de leurs préoccupations. Les enfants et adolescent·es en ont profondément besoin pour grandir, apprendre et s’épanouir…
Notes de bas de page
- 1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant (mis à jour le 3 juillet 2025). [Consulté le 14 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044126586
- 2Par exemple chez nous en Belgique mais aussi en Allemagne, en Suède, au Québec…
- 3oir à ce sujet notre étude : LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. Juin 2025. Sommaire et extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/
- 4Voir à ce sujet nos réflexions sur les smartphones des adultes au sein des organisations et des collectivités dans LETERME, 2025, p. 66-68.
- 5PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, 2025. « Décret relatif à l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école ». 13 mars 2025. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/textes-normatifs/2025-04/53356_0002.pdf
- 6Selon la récente Enquête nationale de Santé réalisée par Sciensano en collaboration avec Statbel, près de 7 Belges (de plus de 15 ans) sur 10 consacrent plus de 4 heures par jour à des activités sur écrans (vidéos, réseaux sociaux, diverses activités sur internet ou jeux vidéo) pendant leur temps libre. FALCINELLI, Sylvia, 2025. « Et chez vous, comment se porte votre temps d’écran ? Où en êtes-vous par rapport à la moyenne belge ? ». rtbf actus [en ligne]. 11 juillet 2025 [Consulté le 16 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/article/et-chez-vous-comment-se-porte-votre-temps-d-ecran-ou-en-etes-vous-par-rapport-a-la-moyenne-belge-11574362
- 7Ces indications sont : référence à l’interdiction dans le règlement d’ordre intérieur de l’école, explication aux élèves lors de l’inscription et communication régulière auprès des parents et des membres du personnel.
- 8VALENTE SOARES, Marie, VREBOS, Pascal, SYLIN, Michel, 2024. « Éducation aux médias : Des dispositifs pédagogiques à penser ». La Ligue [en ligne]. 11 mars 2024. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse : https://ligue-enseignement.be/education-enseignement/articles/dossier/education-aux-medias-des-dispositifs-pedagogiques-penser
- 9À ce sujet, voir notre analyse : LETERME, Caroline, 2020. « L’école, lieu d’apprentissage de la démocratie ? ». CERE asbl [en ligne]. 3 mars 2020. Disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/ecole-lieu-dapprentissage-de-la-democratie/
- 10Information et citation issues de : « Protection des mineurs : l’Union européenne précise les règles pour les plateformes ». Enfance & Jeunesse Infos [en ligne]. 15 juillet 2025. [Consulté le 17 juillet 2025]. Disponible à l’adresse : https://www.enfancejeunesseinfos.fr/protection-des-mineurs-lunion-europeenne-precise-les-regles-pour-les-plateformes/
- 11BROOTHAERTS, Nel (Child Focus), 2025. « Carte blanche : « Interdire les réseaux sociaux aux jeunes : brillante idée ou illusion de sécurité ? » ». rtbf actus [en ligne]. 26 juin 2025. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://www.rtbf.be/article/carte-blanche-interdire-les-reseaux-sociaux-aux-jeunes-brillante-idee-ou-illusion-de-securite-11567327
- 12BROOTHAERTS, 2025.
- 13LETERME, Caroline, 2025. Les numériques dans la petite enfance. Quelles responsabilités et quelles balises ? CERE asbl. 17 juin 2025, p. 51-sv. Extrait disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/les-numeriques-dans-la-petite-enfance-etude-2025/
- 14CSEM, 2024. L’interdiction du smartphone à l’école. Collection « éclairages », n° 3. Septembre 2024, p. 7. [Consulté le 21 août 2025]. Disponible à l’adresse :https://www.csem.be/sites/default/files/2024-10/Eclairages%20smartphone%20(3).pdf
- 15TUAL, Morgan (propos recueillis par), 2025. « La commission d’enquête parlementaire sur TikTok fait son bilan : “Chaque mois qui passe sans régulation, des jeunes sont sacrifiés” ». Le Monde [en ligne]. 24 juin 2025. [Consulté le 17 juillet 2025]. Disponible à l’adresse :
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/06/24/la-commission-d-enquete-parlementaire-sur-tiktok-fait-son-bilan-chaque-mois-qui-passe-sans-regulation-des-jeunes-sont-sacrifies_6615666_4408996.html - 16Dr Mouton rappelle que « nombre de publications soulignent ainsi le rôle néfaste des réseaux sociaux concernant les troubles de l’image corporelle et du comportement alimentaire, les actes d’automutilation (scarification), les tentatives de suicide et les suicides, sans oublier le cyberharcèlement qui, associé au harcèlement “classique”, a des répercussions plus sévères en raison de l’absence de refuge géographique ou temporel pour la victime et de la diffusion large et massive des images et messages harcelants ».Elle mentionne aussi les inquiétudes concernant l’usage exponentiel des chatbots d’intelligence artificielle : « effets sur [la] santé mentale [des jeunes usagers] des chatbots conversationnels investis comme “ami”, mais aussi amplification des pratiques pédocriminelles ». MOUTON, 2025, p. 19-20.
- 17MOUTON, 2025, p. 34.
- 18Nous développons ces considérations sur l’enculturation et l’aliénation numériques dans notre étude susmentionnée : LETERME, 2025, p. 32-33 et 97-99.