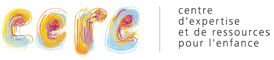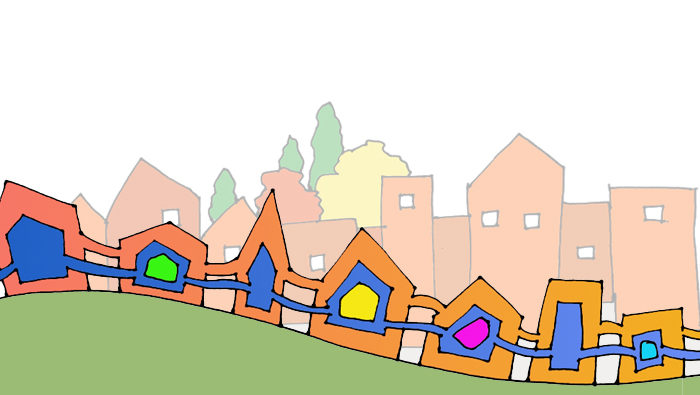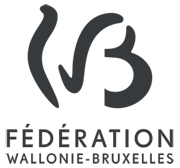Croyance ou « vérité » ?
« Un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant ». Cette croyance sociétale est-elle le corollaire d’un fait sociétal avéré ? D’une « vérité » ?
Boris Cyrulnik1Neuropsychiatre et éthologue. Il est l’auteur de nombreux ouvrages notamment sur le thème de la résilience. a pourtant montré que le nombre de parents qui reproduisent la maltraitance parmi ceux qui l’ont vécue dans leur enfance n’est que légèrement supérieur par rapport à ceux qui en avaient été épargnés2CYRULNIK, Boris, ELKAÏM, Mona, 2017. Entre résonance et résilience. À l’écoute des émotions. (MAESTRE, Michel, dir.). Fabert Eds. Paris. 9 novembre 2017, p. 87. . Selon lui, 95% des enfants maltraités ne reproduiraient pas la maltraitance.
Mais au-delà des chiffres, la question essentielle est : pourquoi certains arrivent-ils à rompre le schéma de reproduction de la maltraitance et d’autres non ?
Pour aborder cette question, il nous faut aller au-delà d’une perspective linéaire et comprendre comment s’entremêlent divers facteurs – individuels, familiaux et environnementaux – dans la reproduction de la maltraitance.
Le rôle de la famille dans la reproduction de la maltraitance
La famille au cœur de la construction identitaire de l’enfant
L’être humain est un être social. Par cet énoncé, aussi banal qu’il peut sembler, nous voulons insister sur le fait qu’aucun être humain ne se construit seul : dans le processus de construction identitaire s’entremêlent à la fois l’autre et soi. Cet enchevêtrement dont résulte « qui je suis » se construit essentiellement dans les interactions sociales, dès les interactions précoces, même si elle se poursuit tout au long de la vie. La famille joue donc un rôle clé dans ce processus.
Avant la naissance, les parents projettent déjà des attentes – positives ou négatives – sur le bébé, qui marqueront leurs manières d’interagir avec lui. Ensuite, dès la première année de vie, la manière dont se passent ces interactions mènera l’enfant à développer une certaine vision de l’autre et de lui-même ainsi que du fonctionnement des relations sociales3Nous développons ce processus dans l’analyse : ACHEROY, Christine, 2024. « Un bébé est né. Et si on parlait d’attachement ? ». Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance (CERE asbl) [en ligne]. Août 2024. [Consulté le 23 décembre 2024]. Disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/un-bebe-est-ne-et-si-on-parlait-dattachement/.
Dans les situations de maltraitance, l’enfant pourra percevoir l’autre comme peu fiable, peu digne de confiance, ou à secourir, et lui-même comme peu digne d’amour, voire mauvais ou responsable… Quant aux interactions sociales, il·elle pourra les voir, par exemple, comme des rapports de pouvoir, de force, peu empreints de bienveillance, de tendresse ou de disponibilité.
En fonction du contenu des images mentales qui émerge chez l’enfant, il·elle développera des stratégies comportementales adaptatives : des colères récurrentes, un gel des sentiments, une posture sacrificielle… qui pourront devenir des traits de caractère plus ou moins stables tout au long de sa vie.
Les interactions familiales constituent le fondement du développement identitaire de l’enfant, mais la famille est également le lieu où opèrent et se superposent deux autres processus ayant un impact sur la construction de soi : les transmissions, liées à l’histoire familiale, et les loyautés. Ces « forces » qui transcendent les individus peuvent les mener à reproduire des actes appris ou subis4DE BECKER, Emmanuel, 2008. « Transmission, loyautés et maltraitance à enfants ». La psychiatrie de l’enfant, Vol. 51(1), p. 45. [Consulté le 23 décembre 2024]. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.3917/psye.511.0043.
Transmissions et résonances émotionnelles
Ce qui se transmet d’une génération à l’autre relève d’une part de ce qui est exprimé verbalement et consciemment : les anecdotes, les normes, les valeurs… et d’autre part, de ce qui est non-dit et peut ne pas être de l’ordre de la conscience. Cette seconde forme de transmission constituerait le lit de possibles dysfonctionnements, maladies ou maltraitances5ANCELIN SCHÜTZENBERGER, Anne. Selon DE BECKER, 2008, p. 58..
Un·e adulte maltraité·e dans son enfance peut, par exemple, vouloir « tourner la page » lorsqu’il·elle se met en couple et fonde une famille. Il·elle pourra tenter d’oublier cette souffrance vécue en la refoulant et en la taisant. Il·elle pourra aussi vouloir la dissimuler par souci de protéger son enfant, parce qu’il·elle pense que la charge émotionnelle qu’induirait l’expression de cette souffrance serait un fardeau trop lourd à porter pour son enfant6CALICIS, Florence, 2006. « La transmission transgénérationnelle des traumatismes et de la souffrance non dite. Thérapie Familiale [en ligne]. 27(3), p. 235. [Consulté le 23 décembre 2024]. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.3917/tf.063.0229.
Mais un vécu traumatique non exprimé, qui n’a pas été mis en récit et fait l’objet d’un travail de remise en contexte, dans une histoire, reste enfoui et s’« enkyste » dans le corps7DE BECKER, 2008, p. 70.. La souffrance n’a pas pour autant disparu et elle risque de réapparaître un jour ou l’autre à travers une situation de « résonnance émotionnelle ».
Dans celle-ci, le parent est confronté, par un trait commun – odeur, ressemblance… – avec son trauma d’enfance non résolu. L’émotion forte qu’il·elle ressent à ce moment s’exprime, non par des mots – il ne fait pas le lien entre cette émotion et son origine – mais par son corps : une crispation, un tremblement de la voix, un rougissement, une pétrification, une agression… L’enfant est alors surpris… la situation est bizarre… il est insécurisé. Il voit son parent bouleversé mais ne reçoit aucune clé de compréhension de la situation.
Plus tard, il pourra alors répéter le comportement qui a induit cette situation, si c’est le cas, afin de tenter de comprendre son parent, lui révélant ainsi sa souffrance. Si le parent refuse de la voir, la situation risque de se cristalliser et de le mener à maltraiter son enfant.
Exemple8CALICIS, 2006, p. 231. : Jeanne, quatre ans et demi, fait une petite bêtise. Sa mère veut la frapper, mais à ce moment, elle voit de la terreur dans les yeux de sa fille. Elle se fige, cette scène la renvoyant à sa propre terreur quand elle était enfant et se faisait battre par son frère. Au lieu de donner la fessée à Jeanne, sa mère, prise par l’émotion, la serre très fort dans les bras. Jeanne ne comprend rien…
La loyauté dans l’axe vertical des générations
Les processus de transmission se mêlent avec des processus de loyauté qui peuvent également participer à la reproduction de la maltraitance. La loyauté de l’enfant envers ses parents s’explique par le don de vie reçu, qui crée une relation irréversible et asymétrique9DE BECKER, 2008, p. 63.. Elle serait donc un devoir éthique et une valeur forte dans l’axe vertical des générations, qui demeure malgré les possibles conflits et ruptures de liens. L’enfant est pris dans un engagement relationnel de probité et de fiabilité envers ses parents qui se traduit par une sorte de « livre de comptes » – affectif – où l’objectif serait de maintenir l’équilibre entre les mérites et les dettes. La loyauté peut ainsi mener un parent à vouloir rembourser une dette envers le passé en se détruisant ou en détruisant un autre – par exemple son enfant10DE BECKER, 2008, p. 64..
Exemple11DE BECKER, 2008, p. 64. : Tom, jeune adulte, décide de prendre son autonomie. Ses parents voient cela comme une trahison, un abandon. Tom rompt les liens avec eux. Des années plus tard, devenu parent, il maltraite ses enfants… qui se retrouvent à vivre chez leurs grands-parents : la dette de Tom envers ses parents est ainsi soldée.
La loyauté de l’enfant devenu adulte envers son parent maltraitant peut aussi s’exprimer par une identification à ce parent. En agissant de la sorte, « il montre qu’il n’est guère meilleur parent, qu’il ne vaut pas mieux que lui. Il maintient de la sorte un lien malgré tout avec ce parent qu’il peut par ailleurs idéaliser en occultant la réalité traumatique12DE BECKER, 2008, p. 51. ».
L’enfant devenu parent : rompre ou ne pas rompre la reproduction de la maltraitance ?
Les processus complexes que nous avons décrits, à l’œuvre dans les familles, agissent comme des « forces » pouvant mener à reproduire la maltraitance vécue d’une génération à l’autre. Mais il n’y a pas de déterminisme ! Tout être humain détient une part de liberté qui lui permet a priori de rompre avec ce schéma reproductif. Néanmoins, se dégager des « nœuds de loyauté », des schémas comportementaux acquis dans l’enfance ou affronter ses traumas demande une énergie psychique et un travail. Il y a aussi un prix à payer13BRISSIAUD, 2001. Selon DE BECKER, 2008, p. 46.. C’est pourquoi, ce processus ne peut être banalisé.
Par ailleurs, le parent qui a souffert de maltraitance dans son enfance ne détient pas toutes les cartes dans son jeu. Dans ce processus, entrent en compte son tempérament, ses capacités mais également des facteurs externes, comme son entourage proche et son environnement plus large.
L’environnement : facteur de protection… ou de vulnérabilité
Le rôle essentiel de l’environnement proche
Quand la famille est maltraitante, c’est à l’extérieur d’elle que l’enfant pourra trouver les ressources nécessaires pour se développer dans le respect de soi et des autres. C’est dans l’entourage immédiat que l’enfant va pouvoir rencontrer des facteurs de résilience et « à chaque étape de l’histoire de l’enfant existe une possibilité de réparation ou d’aggravation14CYRULNIK. Selon MAESTRE, Michel, 2017. Entre résonance et résilience. À l’écoute des émotions […] P. 18. ».
Pour l’enfant, les espaces hors famille sont des lieux potentiels de ressources relationnelles et des endroits sécurisants, parce que normés, avec des limites, un cadre, des repères. Ils constituent des « bulles d’air » où il peut vivre comme tout autre enfant – s’il est protégé par le secret professionnel.
Ce secret est nécessaire pour éviter que l’entourage porte sur l’enfant un regard et des pratiques teintées d’émotions. Car « il faut deux coups pour faire un traumatisme : le premier, dans le réel, c’est la blessure ; le second, dans la représentation du réel, c’est l’idée que l’on s’en fait sous le regard de l’autre15CYRULNIK Selon MAESTRE, 2017, p. 18. ». En voyant l’enfant comme un enfant (sans qualificatif), avec ses ressources et ses capacités propres, l’entourage évitera de l’enfermer dans un statut de victime et l’enfant pourra opter pour la résilience.
Les professionnel·les de « toute première ligne » – ceux et celles qui côtoient presque au quotidien l’enfant maltraité sont appelé·es à être ses « tuteurs de résilience16CYRULNIK, 2017, p. 81. » en devenant ses figures d’attachement.
Leur capacité à apaiser l’enfant en situation d’inconfort, de stress ou de détresse, la constance de leurs comportements et la stabilité du lien développé avec l’enfant lui permettront de se développer et d’élaborer des modèles de représentations de soi et de l’autre compatibles avec des interactions sociales respectueuses à la fois de soi et de l’autre.
Le rôle de l’environnement plus large : physique, institutionnel et axiologique
Les familles qui sont dans des dynamiques de maltraitance n’évoluent pas « hors sol » mais dans des environnements matériels, institutionnels et culturels particuliers que l’on peut analyser comme des systèmes en relation. Ces environnements ne sont pas « donnés », mais produits, construits par nos sociétés à travers l’Histoire. Ils ne sont donc jamais figés mais en cours de transformation. C’est pourquoi, nous avons une certaine prise sur eux, une certaine marge de manœuvre individuelle et collective pour en (re)modeler les aspects quand ils favorisent des dynamiques de maltraitance.
Vivre dans des conditions précaires et/ou dans un logement inadéquat, voir insalubre… Être préoccupé·e chaque jour par le lendemain, sans statut, stigmatisé·e, déraciné·e, seul·e… peuvent favoriser des situations de maltraitance d’enfants et leur reproduction. Mais comment développer des institutions qui puissent garantir aux plus vulnérables un niveau de vie suffisant pour garder leur dignité ?
L’environnement fait également référence aux croyances et valeurs qui constituent le fondement de nos institutions et peuvent soit renforcer ou déforcer les dynamiques de reproduction de maltraitances.
Par exemple, cette idée commune dans notre société qu’ « un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant » n’est pas sans impact sur les jeunes parents qui ont vécu de la maltraitance dans leur enfance. Elle accentue la peur de reproduire la maltraitance vécue et peut parfois induire des comportements autodestructeurs. La maltraitance parentale vécue dans l’enfance peut ainsi se doubler d’une maltraitance sociétale.
Ou encore, la croyance du « manque » de capacités des enfants induit qu’on leur nie un statut d’interlocuteur·rice valable ou qu’on les perçoit encore souvent comme appartenant ou devant se soumettre aux adultes. Elle peut renforcer la reproduction de la maltraitance, soit en voilant sa présence soit en la minimisant17Voir à ce propos : FANIEL, Annick, ACHEROY, Christine, 2023. « L’inceste : l’enfant, la loi, la culture. Changer de regard ». Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance (CERE asbl) [en ligne]. Décembre 202 », p. 79 et 80. Introduction disponible à l’adresse : https://www.cere-asbl.be/publications/linceste-lenfant-la-loi-la-culture-changer-de-regard-etude-2023/.
Enfant maltraité deviendra …
La question de la reproduction de la maltraitance infantile est complexe et inclut de nombreux (f)acteurs. Dès lors, on ne peut la penser selon un modèle linéaire de type agresseur–victime–agresseur. Car l’enfant en devenir et sa famille n’évoluent pas dans un vide social. Et la résilience se tricote là où se « noue une laine développementale avec une laine affective et sociale18CYRULNIK, 2001. Selon MAESTRE, 2017, p. 18. ».
Comment, chacun.e de nous participe de ce processus ? Qu’en est-il de nos croyances et de nos actes ? Offrent-ils aux parents et aux enfants objets de maltraitance la possibilité de penser et d’agir différemment ? Ou les autorisent-elles/enferment-elles dans un statut ou un rôle qui favorise la reproduction de la maltraitance ?