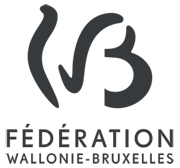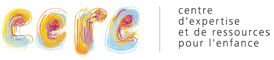Promouvoir
l'égalité la dignité l'égalité la dignité l'égalité l'égalité la dignité l'égalité la dignité l'égalité
Promouvoir
l'égalité la dignité l'égalité la dignité l'égalité l'égalité la dignité l'égalité la dignité l'égalité
des enfants
Le Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance (CERE asbl) est un centre d’éducation permanente et de recherche dans le domaine de l’enfance (0-18 ans), qui vise à promouvoir la dignité et l’égalité des enfants.
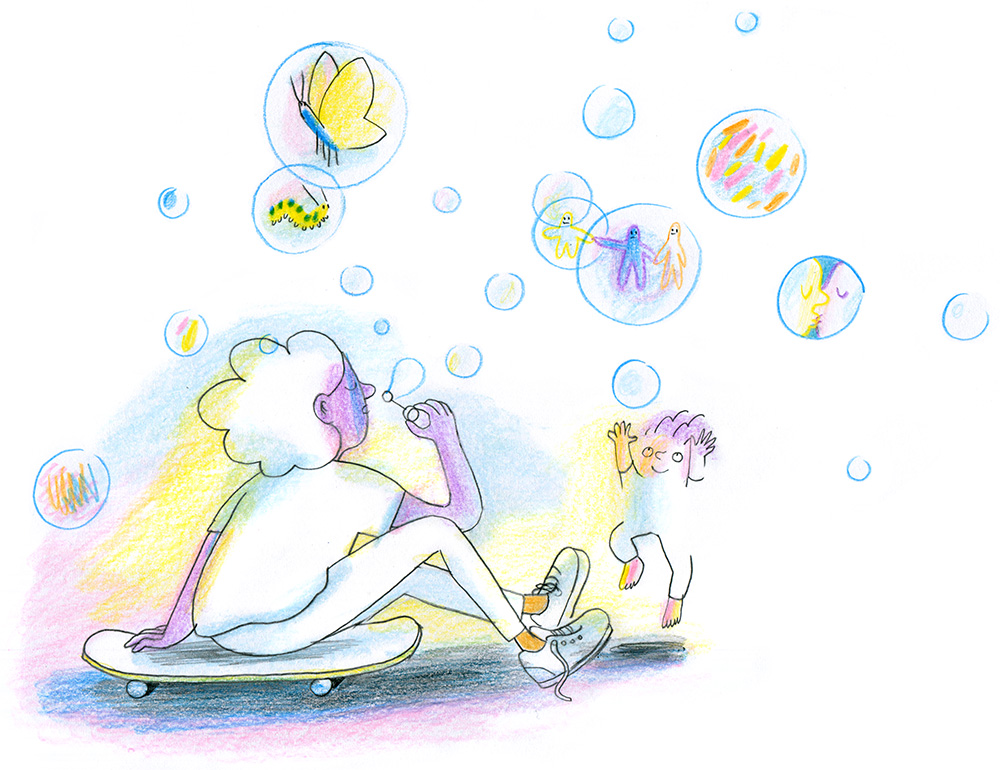
Nos thématiques
L’actualité du CERE
Notre vision
Promouvoir l’égalité entre les enfants
Investir dans l’enfance, c’est intégrer cette donnée dans une perspective transversale touchant à des compétences très diverses telle que l’accueil de l’enfant, bien sûr, mais aussi l’éducation, l’environnement, les travaux publics, la participation, l’égalité des chances, la santé, la cohésion sociale…

Nos publications
L’ensemble de nos analyses et de nos études en accès libre, publiées en vue d’informer et d’apporter un regard critique sur des thèmes d’actualité en lien avec l’enfance.

Nos formations
Nous proposons des formations autour de différentes thématiques liées à l’enfance. Elles sont destinées aux professionnel.les de l’enfance ou à toute personne intéressée

Nos évènements
Vous êtes parent ? Futur parent ? Ou vous vous intéressez aux questions liées à l’enfance (0-18 ans) : rejoignez-nous !

Nos Thématiques
Nous regroupons et mettons en avant ici des ressources par et pour des acteur.trices du secteur de l’enfance.
Newsletter
Chaque mois, les informations utiles
du secteur de l'enfance
CERE asbl
Le Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance est un centre d’éducation permanente et de recherche dans le domaine de l’enfance (0-18 ans).
Rue de la Poste 105, B-1030 Bruxelles
+32(0)476 983 741 info(at)cere-asbl.be